Par akademiotoelektronik, 05/06/2022
L’accroissement de puissance par l’espace | Ecole de Guerre Economique
Comme chaque 12 avril, la mission de Gagarine est célébrée avec une immense fierté partout en Russie. Mais cette année, le soixantième anniversaire de cette grande victoire de l’URSS dans la course à l’espace qui l’opposait aux États-Unis n’a laissé aucuns doutes sur les difficultés du secteur spatial russe, entaché par la corruption et en manque d’innovation fautes de financements suffisants. Elle a perdu l’année dernière le monopole des vols habités vers l’ISS dont chaque place dans la légendaire fusée Soyouz était facturée plusieurs millions de dollars par Roscosmos aux autres agences. La concurrence de Space X, la société d’Elon Musk, qui a mis un terme au leadership russe en matière de vols spatiaux, symbolise la nouvelle dynamique de la conquête spatiale : le New Space.
L’émergence du New Space
Pendant la Guerre froide, le Old Space était dominé par les superpuissances géostratégiques et militaires concurrentes qu’étaient les États-Unis et l’URSS. Le Japon et l’Europe ont contribué à l’exploration spatiale grâce aux importants investissements dans le secteur spatial durant les Trente Glorieuses, bien qu’ils aient joué un rôle secondaire derrière les deux géants. Avec la victoire progressive de l’idéologie libérale et l’accélération de la mondialisation, de nouveaux pays ont pénétré le marché spatial, comme Israël, l’Iran, la Corée du Sud, l’Inde et surtout la Chine. L’arrivée de ces nouveaux entrants n’a pas modifié pour autant l’ancien modèle du marché spatial fondé sur des monopoles d’États pour seuls acteurs et sur l’exploration scientifique pour unique enjeu.
La transformation du Old Space en New Space est le résultat de trois phénomènes : l’ouverture de l’espace à de nouveaux acteurs essentiellement privés, à de nouveaux champs d’application y compris militaires, et dans le but de poursuivre de nouveaux objectifs y compris financier. Le New Space peut se définir ainsi comme la privatisation et la réduction du coût de l’accès à l’espace. En définitive, c’est l’ubérisation de l’industrie spatiale.
En réalisant des partenariats avec les entreprises californiennes de hautes technologies, la NASA bénéficie des innovations du numérique. La donnée spatiale intègre ainsi le Big data et devient le cœur de l’activité économique du New Space en rentabilisant les investissements grâce à son utilisation pour une importante variété d’applications et de services commerciaux. Pour le moment, les gouvernements restent des clients incontournables mais lorsque des sociétés commerciales privées telle que Space X ne dépendront plus des financements d’institutions publiques comme la NASA mais uniquement de fonds privés, la croissance du marché spatial deviendra autonome par rapport aux États.
Une conquête de plus en plus massive
La miniaturisation des satellites est l’un des principaux leviers de croissance de ce nouveau business pour permettre à de nouveaux acteurs d’accéder à des coûts de lancement et de mise en orbite de satellite compétitifs. À ce titre, le peuplement en cours de l’espace par des constellations massives de dizaines de milliers de satellites, dont le projet Starlink est le plus emblématique, vise à couvrir l’intégralité du globe pour donner un accès internet à toutes les zones, mêmes les plus dépourvues, d’antennes terrestres. L’effet de cette politique de réduction des coûts d’accès à l’espace est la multiplication d’acteurs en compétition dans l’exploitation commerciale de l’espace pour gagner des parts de marchés. Ce foyer d’innovation forme le socle d’une nouvelle industrie qui financera autant l’exploration scientifique de Mars comme de l’espace lointain, l’exploitation minière de la Lune et des astéroïdes ou encore le tourisme suborbital.
En dépit de l’émergence d’une nouvelle ère de la conquête spatiale qui s’accompagne de l’imaginaire homérique que l’homme porte au cosmos, quelles dynamiques permettent de conclure une extension des rivalités géostratégiques de la Terre à l’espace avec l’émergence du New Space ?
Les États-Unis à l’assaut du droit international de l’espace
L’environnement de la société contemporaine est très dynamique. Dans la mesure où l’information est en situation d’abondance, ce sont les technologies capables de traiter l’information rapidement qui créer de la valeur. Or quoi de mieux qu’un algorithme comparé à des analystes humains ? Uber ne possède pas un seul taxi au monde ni Airbnb de biens immobiliers. Le point commun entre ces entreprises qui ont réinventé totalement le business model de filières traditionnelles ? Elles sont américaines. Par conséquent, ce n’est pas un hasard si c’est aux États-Unis que le New Space a émergé et que c’est ce pays qui soit à l’œuvre pour imposer au reste du monde sa propre vision juridique censée encadrer l’exploitation des ressources spatiales qu’implique directement le New Space. C’est une source de rivalité géopolitique majeure.
Le traité de l’espace ratifié en 1967 par la majeure partie des États dont les principales puissances spatiales de l’époque, a permis de poser les fondements juridiques relatifs à l’exploration et l’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique. Il pose le principe fondamental de la liberté d’accès des États à l’espace sans que l’un d’eux puisse se l’approprier de manière que cette liberté ne s’exprime uniquement dans un cadre pacifique, interdisant toute forme de guerre ou de prédation territoriale dans l’espace.
Alors que toute forme d’appropriation des corps célestes est prohibée par le traité, l’exploitation commerciale et industrielle de leurs ressources naturelles semblent pour autant aller contre ce principe.
L’accord sur la Lune signé en 1979 à l’ONU prolonge cette notion de propriété en déclarant res nullius le statut légal de Lune, ce qui signifie que personne ne la détient, au même titre que la haute mer hors zones territoriales ou l’Antarctique. De plus, les États s’engagent à établir « un régime international régissant l’exploitation des ressources naturelles de la Lune (et des autres corps célestes) lorsque cette exploitation sera sur le point de devenir possible », devant notamment permettre une « répartition équitable entre tous les États parties des avantages qui résulteront de ces ressources, une attention spéciale étant accordée aux intérêts et aux besoins des pays en développement ». Comme l’explique Julien Mariez, chef du service juridique du Centre national d’études spatiales (CNES), l’orientation quasi collectiviste de ce second accord a largement compromis son acceptation par la communauté internationale, à commencer par les États-Unis : à l’heure actuelle, seuls dix-huit États sont signataires de l’accord de 1979, parmi lesquels ne figure aucune grande puissance spatiale.
L’enjeu des ressources avant la recherche d’appropriation
La perspective d’une exploitation des ressources spatiales accompagne l’émergence du New Space à partir des années 2010 aux États-Unis, entre la création de sociétés privées comme Planetary Ressources ou Deep Space Industries et la diffusion de rapport de think tanks en faveur de la propriété privée dans l’espace.
L’adoption du Space Act américain en 2015 autorise les citoyens américains impliqués dans l’exploitation des ressources spatiales à récupérer, posséder, transporter, utiliser et vendre ces ressources. Une activité considérée par les États-Unis comme n’étant pas contraire au principe de non-appropriation du Traité de l’espace, dans la mesure où, poursuit Julien Mariez, les ressortissants américains ne s’approprieraient pas les corps célestes eux-mêmes mais uniquement leurs ressources, une fois extraites.
À ce titre, la NASA a dépensé 1 milliard de dollars dans le programme OSIRIS-Rex pour lancer en 2016 une sonde spatiale qui ramènera sur Terre en 2023 un échantillon de l’astéroïde Bénou.
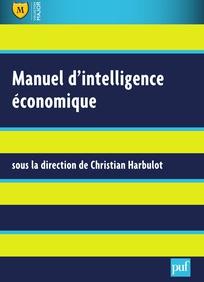
Le traité de l’espace semble néanmoins inadapté pour déterminer si le principe de non-appropriation des corps célestes tolère l’appropriation de leurs ressources puisque cette problématique ne se posait pas à l’époque de son élaboration et qu’il laisse désormais un vide juridique libre d’interprétation.
Alors que le Luxembourg en 2017 et les Émirats arabes unis en 2020 adoptèrent une législation analogue à la position américaine, le comité de l’ONU en charge de cette question juridique ne dispose d’aucun mandat pour poser un cadre normatif international et le faire respecter. Sans surprise, la Russie dénonce les initiatives américaines visant à règlementer unilatéralement l’activité industrielle spatiale quoiqu’elles se trouvent renforcée par la paralysie de l’Union européenne qui ne parvient pas à trouver de consensus pour constituer un groupe de travail sur cette question.
Le 6 avril 2020, un Executive Order (décret présidentiel) réaffirme le droit des citoyens américains exprimé par le Space Act de 2015. En octobre de la même année sont signés les accords Artemis qui confèrent à la position américaine une force juridique à l’international grâce aux États affiliés.
La gouvernance des activités spatiales sur les corps célestes semble ainsi se formaliser autour de normes internationales élaborées autour de la vision américaine. L’échec du multilatéralisme onusien devant les accords Artemis a suscité l’ire du directeur général de Roscosmos qui trouve dans cette initiative un parallèle avec l’invasion militaire de l’Iak ou de l’Afghanistan.
Les États-Unis installent l’échiquier et l’un des principaux pions est le programme Artemis qui vise le retour de l’homme sur la Lune d’ici 2024. Étape obligatoire avant la conquête de Mars, ce programme postule ouvertement que seule l’utilisation des ressources naturelles de la Lune et de Mars permettra de s’y installer durablement. Par ailleurs, la construction de l’atterrisseur lunaire dans le cadre de ce programme a été à l’origine d’une rivalité intense à l’été 2021 à la suite du rejet par la NASA du contrat avec Blue Origin et Dynetic au profit de Space X. Ce programme s’inscrit pleinement dans la logique de partenariats publics – privés mis en place par la NASA avec la multitude des nouveaux acteurs du New Space où le Big data constitue l’un des principaux levier d’action.
La Chine et la Russie contre-attaquent
Les trois agences spatiales historiques établis depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale ne disposent pas des mêmes ambitions ni des mêmes moyens. Roscosmos et l’ASE, avec leurs financements respectifs de 5,5 milliards d’euros (2014) et 6,68 milliards d’euros (2020), ne peuvent prétendre à la même diversité d’opérations que la NASA et ses 22,6 milliards de dollars (2020). L’Inde et son budget spatial de 1 milliard d’euros (2016) possède trois modèles de lanceurs et met en orbite des satellites qu’elle produit de manière autonome depuis le début des années 2000. Le club restreint des puissances spatiales, aujourd’hui au nombre de onze, tend à s’agrandir.
Mais c’est bien la Chine, forte de son budget spatial de 8,3 milliards de dollars estimé par l’OCDE en 2020, qui se pose comme le principal rival des États-Unis. La dernière version de son lanceur Longue Marche (Chang Zeng en chinois) est réutilisable pour venir concurrencer l’innovation de Space X. Le 17 juin 2021, la Chine a envoyé trois hommes pendant trois mois dans l’espace vers le premier module de sa station spatiale, la CSS. Dans un contexte de tension avec l’Occident, la Chine s’est résolue à construire sa propre station spatiale après le refus des États-Unis de la laisser participer au projet de la Station Spatiale Internationale (ISS) tandis que cette dernière doit prendre sa retraite en 2024. Le démantèlement de l’ISS pourra être retardé au plus tard à 2028 et pour le moment, aucun projet de coopération équivalent pour faire suite n’est en discussion entre les membres qu’elle réunit, à savoir l’Europe, les États-Unis, la Russie, le Canada et le Japon. On ne peut que regretter que les tensions russo-américaines aient également fragilisé la coopération spatiale, l’un des rares secteurs de coopération préservé entre les deux adversaires géopolitiques.
Par ailleurs, le 9 mars 2021, le directeur général de Roscosmos et son homologue chinois ont signé un accord prévoyant la construction conjointe d’une future station lunaire. Le texte stipule que celle-ci sera « ouverte à tous les pays et partenaires internationaux intéressés, renforcera les échanges de recherche scientifiques et favorisera l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique par l’humanité à des fins pacifiques ». Une station concurrente au projet de construction de la station Lunar Gateaway des États-Unis en partenariat avec l’Europe, le Canada et le Japon. Aucun calendrier n’est cependant avancé concernant le projet de coopération sino-russe mais d’ores et déjà, les systèmes d’alliances géopolitiques terrestres se projettent sur la Lune.
Une émulation post-communiste dans les défis lancés à l’Occident
La collaboration spatiale du tandem sino-russe s’inscrit dans une démarche de coopération de long terme, fortement favorisée par l’isolement que leur impose l’Occident. Mais elle trouve sa justification également dans leur nécessité de palier leurs retards respectifs, Moscou offrant ses compétences dans le domaine de l’habitation de l’espace et des essais techniques en échange des ressources industrielles et technologiques de Pékin.
Contrairement aux velléités unilatérales assumées des États-Unis, les Russes et les Chinois diffusent une novlangue favorable à une exploration et une exploitation pacifique de l’espace, conformément au traité le régissant. Quand bien même un consensus juridique serait trouvé entre les grandes puissances spatiales, cette guerre de l’information entre les deux systèmes d’alliance occidental et sino-russe risque de se maintenir durablement avec le dessein de délégitimer les ambitions de l’autre auprès de l’opinion mondial.
Cette rivalité renoue même avec l’âge d’or de la Guerre froide à travers une course au cinéma, lancée depuis plus d’un an. En octobre 2021 était programmé le départ de deux équipes de tournages à bord de l’ISS, l’une russe, l’autre américaine. D’un côté, le projet américain avec 200 millions de dollars et un quatuor Tom Cruise – Space X – NASA – Universals aux commandes ; de l’autre, un projet conjoint entre la première chaîne TV russe Channel One et Roscosmos pour un film intitulé Challenge. L’objectif : décoller en premier pour bénéficier du statut de pionnier historique du premier film tourné dans l’espace. Arrivée le 8 octobre à bord, c’est finalement le projet russe qui a réalisé cette première mondiale avant de rentrer sur Terre le 16 octobre. Une victoire permettant de faire la promotion du programme spatiale russe et de sa modernité, malgré ses retards et sa corruption.
L’émergence d’une conflictualité potentielle
Pour comprendre l’accélération soudaine de l’attention portée aux enjeux de défense dans l’espace, il faut contextualiser les grands bouleversements que connaissent les activités humaines en lien avec le cosmos. Comme nous venons de le voir, la révolution de l’exploration spatiale, les ruptures technologiques telles que l’apparition des constellations de nano satellites ou des lanceurs réutilisables, l’arrivée d’acteurs privés du New Space, les perspectives de colonisation et d’exploitation des ressources d’autres planètes dans un avenir proche ont contribué à faire de l’espace un enjeu économique. Mais l’espace est aussi un enjeu sécuritaire avec le retour des rivalités entre puissances et leur désormais possibles affrontement militaires directs. Les fonctions offertes par les satellites seront indispensables en cas de tels conflits, que ce soit pour la télécommunication, le guidage, le positionnement et le renseignement. Si une puissance parvenait à obtenir la supériorité dans l’espace extra-atmosphérique, nuls doutes qu’elle retirerait un avantage sur la conduite des opérations militaires à la surface de la planète, avantage difficilement compensable par les autres puissances.
De nouveaux comportements des puissances ont commencé à être observé. En 2017 par exemple, un satellite espion russe est venu se placer au plus près d’un satellite de télécommunication militaire français.
Le ministère des armées a rendu cette information publique en évoquant une tentative d’espionnage. Après la création de l’US Space Force en 2019, le président américain Donald Trump déclara que « l’espace est le nouveau front de guerre du monde ». Les États-Unis disposent d’une armée de l’espace autonome. La Russie, la Chine, la France et l’Iran disposent eux d’un commandement de l’espace. D’autres devraient bientôt suivre leur exemple.
Le colonel Christophe Michel concluait le lancement du premier exercice militaire spatial français AsterX par ces mots : « vous êtes des combattants de l’espace ». Cet exercice, piloté par le Commandement de l’Espace (le CDE, qui dépend de l’armée de l’Air et de l’Espace), était une première historique pour la France. Il s’agissait d’une simulation de crise majeure avec des scénarios présentant différentes puissances s’affrontant dans l’espace extra-atmosphérique. AsterX démontre que les problématiques de sécurité et de défense s’expriment dans cinq champs distincts de confrontation : la terre, la mer, l’air, le cyberespace et désormais l’espace extra-atmosphérique. Nous assistons aujourd’hui à une militarisation de l’espace et l’émergence d’un véritable nouveau champ de conflictualité. L’intensification des menaces spatiale a amené la ministre des armées française, Florence Parly, a évoqué en 2017 une nouvelle « guerre des étoiles ».
Panorama des ambitions de la France dans l’espace extra-atmosphérique
Durant la période 2018-2023, la France connait un renouvellement de l’ensemble de ses dispositifs militaires placés en orbite. L’objectif principal est de renforcer les capacités actuelles de veilles stratégiques et d’appuis aux opérations militaires.
Tout d’abord, les télécommunications militaires. À travers le programme SYRACUSE, l’armée française bénéficie d’un réseau de communication stable et sécurisé. Le 24 octobre 2021, le premier satellite d’une constellation de nouvelle génération SYRACUSE IV a été lancé avec succès depuis Kourou pour remplacer progressivement la constellation précédente de SYRACUSE III en service depuis 2007. Ils apporteront une hausse significative des débits de données ainsi qu’une meilleure résistance aux brouillages.
Ensuite, l’observation optique de la Terre permet entre autres de suivre l’évolution de la construction d’installations militaires (par exemple sur des îles en mer de Chine) ou de de fournir des renseignements à des troupes au sol concernant les mouvements de groupes djihadistes dans les sables du Mali. Pour remplir ces missions, la DGA a lancé trois programmes de satellites : HELIOS, CSO (Composante Spatiale Optique) ainsi que PLEIADES. Le successeur du programme CSO est déjà connu, il se nommera IRIS et devrait être déployé à l’horizon 2030. Le troisième et dernier satellite de la constellation CSO devrait être lancé en 2022.
Enfin, l’écoute grâce au programme CERES (Capacité d’Écoute et de Renseignement Électromagnétique Spatiale). Résultat de plusieurs décennies de recherches de la part du CNES et de la DGA, il est composé de trois mini satellites espions dont le but sera de faire du renseignement basé sur l’observation et la cartographie des émissions électromagnétiques. En d’autres termes, il permettra de repérer, de quantifier et de cartographier les émissions radios, radar et électroniques d’éventuelles armées adverses. Le triplet de satellites sera mis en orbite le 16 novembre 2021. Il est à noté qu’avec Cérès, la France va rentrer dans le club très restreint des pays qui possèdent une telle technologie ; seuls les États-Unis, la Russie et la Chine disposent de satellites similaires. Ce programme se verra remplacer à l’horizon 2030 par le programme CELESTE.
La France a ainsi effectué en ce début de décennie 2020 le renouvellement et l’expansion de ses capacités satellitaires. Tous ces moyens apporteront une aide indispensable à la conduite d’opérations militaires que ce soit sur terre, sur mer ou dans les airs. Il devient aujourd’hui quasiment impossible pour l’État-major d’envisager la réussite d’une opération militaire sans les outils satellitaires. Ces outils, de plus en plus précieux, sont pourtant dénués de systèmes de protections si bien qu’ils sont exposés à toutes actions malveillantes de pays pouvant souhaiter porter atteinte à la capacité d’action militaire de la France. C’est alors que le changement de doctrine et la création d’un commandement de l’espace prend tout son sens. La France comprend que sa flotte de satellite lui est essentielle et qu’elle est devenue de facto un élément de vulnérabilité. Le développement d’une capacité de défense spatiale française apte à protéger ses intérêts dans l’espace est aujourd’hui déclenché. En termes de doctrine, il s’agit de passer d’une maîtrise de l’espace à un contrôle de l’espace ; c’est-à-dire de passer d’une simple capacité d’utilisation de ce milieu à la possession de moyens capables d’agir dans ce milieu. Le spatial français va donc se dédoubler, d’une simple fonction de soutien aux activités de sécurité sur Terre, il va dorénavant également remplir des missions de sécurité des activités dans l’espace. C’est l’objet du programme ARES (Action et résilience spatiale). À l’origine de l’exercice AsterX, il implique le renforcement des moyens de surveillance et de détection dans l’espace, l’ajout et l’intégration de protections passives sur chacun des nouveaux satellites et enfin le développement de capacités d’actions dans l’espace. Ces trois catégories d’activités matérialiseront la nouvelle stratégie spatiale de défense et de riposte française.
Le renforcement du renseignement spatial français
Premièrement, le renforcement des moyens de surveillance et de détection dans l’espace. Pour l’observation de l’orbite basse, la France dispose du programme GRAVES (Grand réseau adapté à la veille spatiale) entré en service opérationnel en 2005 et développé par l’ONERA (l’Office national d’études et de recherches aérospatiales). Il détecte les objets en orbite basse entre 400 et 1000 kilomètres d’altitudes. Il est constitué d’un système radar fixe au sol qui observe les cibles traversant le ciel. Il permet donc aux militaires français d’avoir des informations sur les mouvements des satellites et autres objets en orbite basse. Seuls les États-Unis, la Russie et la Chine, comme bien souvent, disposent d’une telle capacité. Mais le système GRAVES accuse aujourd’hui son âge, notamment face au développement de satellites furtifs et de nano satellites. Son successeur est donc en cours de définition mais il est d’ores et déjà prévu de moderniser GRAVES pour préserver sa capacité opérationnelle jusqu’à l’horizon 2030.
Concernant la surveillance de l’orbite géostationnaire, les moyens utilisés sont le réseau de télescopes Tarot du CNRS. Ces capacités sont complétées par les services de GEOTracker mis en place par Ariane Group. Ce dernier s’appuie sur un réseau de six télescopes à travers le monde qui ont permis d’identifier notamment le satellite russe responsable de l’espionnage du satellite franco-italien en 2017. De nouveaux télescopes feront probablement l’objet d’un développement à l’échelle européenne pour augmenter les capacités de détection.
Ensuite, le programme YODA (Yeux en orbite pour un démonstrateur agile) a pour objectif la protection des satellites français qui est devenue une priorité pour le ministère des armées.
Le problème est que personne n’a encore d’idées précises de ce à quoi pourrait ressembler un conflit dans l’espace. Différentes pistes ont déjà fait l’objet de développement par certaines puissances. Les travaux les plus avancées dressent la liste potentielle suivantes :
. Tout d’abord, les armes cinétiques : les missiles et les balles. Elles ont le défaut d’engendrer de nombreux débris au moment de la destruction du satellite, ce qui peut se révéler contre-productif pour l’ensemble des nations, y compris pour celle ayant lancée l’attaque. À ce jour, seuls les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde ont fait la démonstration de la maîtrise des missiles antisatellites.
. Puis, les armes à énergie dirigée : les lasers ou les impulsions électromagnétiques. Les lasers ont l’avantage de pouvoir être dosé selon le niveau de dommage que l’on veut causer à un satellite, en partant d’un simple éblouissement des capteurs jusqu’à l’atteinte structurelle potentiellement destructrice pour le satellite ciblé. L’ONERA travaille depuis 2016 sur le développement de laser : un tir depuis le sol a réussi à neutraliser momentanément un vieux satellite d’observation français. Il est donc probable que le laser sera la technologie phare des premiers satellites défensifs français
La menace du piratage informatique
On croise ici les deux nouveaux champs de conflictualité, le cyberespace et l’espace extra-atmosphérique. On peut ici envisager la possibilité par piratage de prendre le contrôle d’un satellite et de lancer une procédure de désorbitage par exemple, que cela soit en plongeant le satellite dans l’atmosphère ou en l’envoyant dans les confins du cosmos. Il est fort probable que les prochaines générations de satellites, IRIS et CELESTE, bénéficieront de protections plus complètes, plus aptes à protéger le satellite contre un large éventail de menaces.
Les satellites YODA représentent alors un renfort d’un nouveau type. Confié au CNES, ce programme sera déployé à la fin de la décennie. Ce futur garde du corps des satellites SYRACUSE aura pour mission de se placer à proximité de ces derniers et d’assurer leur surveillance dans leur environnement immédiat.
En dernier lieu, les capacités d’action dans l’espace. Les satellites YODA représenteront une protection pour les satellites français géostationnaires. Cependant, ils n’offriront pas une protection aux satellites situés en orbite basse. Afin de ne pas laisser ces derniers sans protection, on peut penser à un développement de système de lasers basé au sol. Outre les lasers et les satellites, la capacité d’action pourrait passer aussi par un véhicule spatial manœuvrant à l’image du drone américain X-37. L’État-major français envisage le développement de ces capacités à l’horizon 2035 qui offrirait une capacité d’action considérable dans l’orbite basse à la France. À ce titre, le Space Rider, un concept développé par Thalès Alenia Space et l’Italien Avio, constitue le projet européen le plus avancé à ce stade. Ce véhicule spatial permettra en effet une certaine souplesse d’action comme la possibilité de capturer un satellite endommagé, de le ramener sur Terre pour le réparer puis de le replacer en orbite. Un tel drone armé représenterait également un formidable système d’arme en orbite avec un armement reconfigurable à chaque retour sur Terre et une résistance face aux armes à énergie dirigée grâce à son bouclier thermique.
Tout bien considéré, la France et les puissances au sens général du terme sont plus avancées que ce que l’on pourrait penser. Mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes que dans les prémices de la guerre spatiale. Les enjeux économiques qui accompagnent l’essor de l’industrie spatiale risquent de prendre dans un avenir proche une ampleur telle qu’il sera sans doute délicat d’empêcher l’aggravation des tensions et des rivalités de pouvoirs entre les grands acteurs, publics comme privés. En admettant que la règlementation libérale et pacifique instaurée dans le traité de 1967 est incompatible avec l’exploitation des ressources spatiales, l’avènement d’un cadre normatif étendant au cosmos le principe de propriété privée est-il inévitable ? Face à l’alliance des démocraties occidentales, les ressources à dispositions des principaux adversaires russes et chinois seront-elles suffisantes pour empêcher une domination des États-Unis ? À terme, une fois que l’industrie spatiale privée s’émancipera de la mainmise des États, est-ce qu’au profit d’une nouvelle forme de guerre économique les alliances ne vont-elles pas éclater ? Et quand bien même ce rapport de force s’équilibrerait entre les acteurs ou à l’inverse pencherait en faveur d’une puissance hégémonique, plus rien ni personne ne semble pouvoir empêcher la transformation de la conquête spatiale en véritable guerre des étoiles.
Louis-Marie Doly
Articles Liés